Des jardins en prison ?
« Les jardins permettent de maintenir vivaces les capacités d’apprentissage des personnes détenues, leur curiosité
et leur créativité, et de développer des compétences transférables, à la sortie, dans d’autres activités. »
Extrait du Livre Blanc « Des jardins pour les prisons »
En agissant sur différents déterminants de la santé, en favorisant l’estime de soi et en créant un lien « dedans-dehors », les jardins collectifs en milieu pénitentiaire ont un réel pouvoir tant sur la promotion de la santé que sur le parcours de réinsertion sociale.
« Les avis sont unanimes : il est urgent de se pencher sur la problématique des conditions de détentions des personnes privées de liberté (Amnesty, 2023 ; Conseil de l’Europe, 2022 ; WHO, 2014). Autrement dit, si rien n’est fait, le fossé des inégalité sociales de santé, déjà présentes chez les personnes détenues à leur entrée en prison, va se creuser d’avantage et la société toute entière en paiera les conséquences (ONU, 2019) ![]()
![]() Or, la participation aux potagers collectifs en prison donne la possibilité d’atténuer les inégalités en matière de santé. Pour y parvenir, un changement de paradigme est nécessaire et ce, afin d’atteindre une vision holistique et positive de la santé, comprenant le bien-être et les habilités nécessaires à la réinsertion (Devine-Wright et al., 2019). » conclut Laetitia Callebaut en 2023 dans son mémoire sur la question.
Or, la participation aux potagers collectifs en prison donne la possibilité d’atténuer les inégalités en matière de santé. Pour y parvenir, un changement de paradigme est nécessaire et ce, afin d’atteindre une vision holistique et positive de la santé, comprenant le bien-être et les habilités nécessaires à la réinsertion (Devine-Wright et al., 2019). » conclut Laetitia Callebaut en 2023 dans son mémoire sur la question.
En France, l’Association Nationale des Visiteurs de Prison (ANVP) et Green Link ont réalisé une enquête nationale auprès d’une trentaine de jardins en prison. Leurs conclusions sont très positives. Les jardins dans des lieux d’enfermement et de d’exclusion sociale permettent d’améliorer la qualité de vie, et plus précisément de :
- De favoriser la réinsertion en proposant un outil « dedans-dehors » : développer en prison des compétences utiles en dehors
- De réduire le stress et l’anxiété, tout en réduisant la prise de médicaments
- D’améliorer l’état de santé physique (notamment condition physique)
- D’améliorer les compétences relationnelles et donc la solidarité et le lien social
- D’augmenter le respect envers l’environnement et les autres
- D’augmenter le sentiment de responsabilisation face à un projet commun
Selon Charles-Edouard Lambert, permettre aux détenus de travailler la terre était vu comme un outil particulièrement pertinent pour favoriser la réinsertion sociale. Cela était d’ailleurs pratique courante dans les prisons françaises jusqu’au 19ème siècle. Ces pratiques ont quasiment disparu au 20ème siècle, avec une suppression des espaces verts au sein des établissements. Cependant, le 21ème siècle pourrait redorer l’image des jardins en prison en redonnant à ces jardins leur place dans la réinsertion socio-professionnelle, l’amélioration de la qualité de vie en institution et, face aux défis climatiques, dans la sensibilisation à la préservation de l’environnement.
Envie d’en savoir plus ?
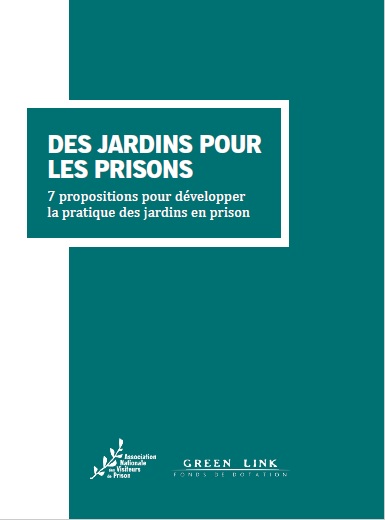
Retour d’expérience sur le jardin en prison à Hasselt, en Flandres chez Terra Therapeutica : https://terra-therapeutica.be/?page_id=3283
Retour d’expérience en France : https://plusdevertlessbeton.com/monter-un-projet-jardin-en-prison-2
Laetitia Callebaut (2023) « Les jardins collectifs : levier potentiel pour la promotion de la santé dans le milieu carcéral belge? Étude du cas de Vent Sauvage » https://dial.uclouvain.be/memoire/ucl/object/thesis:41255
Charles-Edouard LAMBERT (2023) « Hortithérapie en milieu pénitentiaire : quelle place pour les équipes soignantes de psychiatrie ? » https://f-f-jardins-nature-sante.org/wp-content/uploads/2023/07/Memoire-DU-LAMBERT-Ch-Edouard.pdf
L’image de design de jardin publiée est tirée du site de nos voisins Terra Therapeutica
